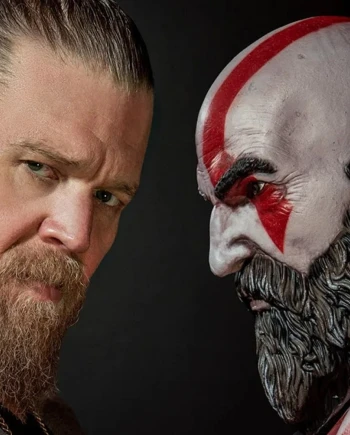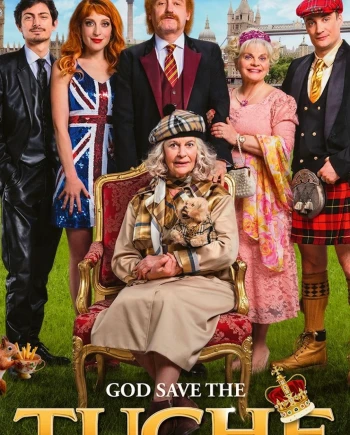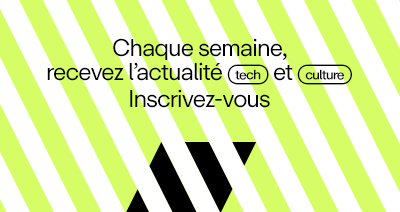Jean, ce film est‑il né de votre initiative ?
Jean Dujardin : oui, c’était un désir, voir ce que ça donnerait de refaire un film comme celui‑là en 2025. J’avais envie de me plonger dans cette « petitesse », de voir un film comme ça de nos jours. Mais pas forcément pour en être. L’idée première, c’était l’envie de voir L’homme qui rétrécit, version moderne. Mais je fais souvent ça… Que ce soit pour Lucky Luke, pour Zorro… Je me dis : « Tiens, j’ai envie d’être dans un western, je veux voir ce film, alors je lance le projet ». Donc, si on me donne l’autorisation, si on a les droits, si Jan est OK, si on a le budget… Eh bien, c’est super. Allons‑y !
Mais l’envie, c’était de vous voir dans cette histoire ou de rendre hommage aux films des années 50 ?
Jean Dujardin : il y a une volonté de vintage, totalement assumée dans le film. On a travaillé sur la lenteur des plans, mais c’est surtout une question de point de vue, et là, c’est le travail de Jan.
Jan, quand Jean vous a parlé du projet, vous êtes‑vous tout de suite projeté dans ce film sur fond bleu, avec tous ces plans truqués ?
Jan Kounen : non, pas du tout. Ces questions viennent après. Quand on commence un film, il ne faut pas se demander comment on va le fabriquer, mais si on a envie de le faire. Il faut qu’il y ait cette énergie‑là. Ma première réaction, c’était : « L’idée est géniale ! ». Faire une nouvelle adaptation de ce roman, un remake, mais aussi notre film à nous. Raconter cette histoire d’un homme qui vit dans un monde qui, chaque jour, s’agrandit, qui découvre l’impermanence… Une aventure initiatique, en somme.
Une fois ce principe posé, une fois que l’on était d’accord avec Jean et le producteur sur ce qu’on voulait raconter, la question devient : comment on fait ça ? Et là, les choses se compliquent. Raconter l’histoire d’un homme qui rétrécit, ça implique des lois optiques, des défis techniques. Très vite, on a voulu garder une référence au film original, son côté artisanal, fait main, presque organique. Donc, pas question de tout faire en 3D hyperréaliste. Effectivement, nous avons utilisé des décors en 3D là où on ne pouvait pas faire autrement, mais l’idée était de retrouver un certain style. Et bien sûr, nous avons aussi tourné en partie sur fond bleu, ce qui n’était pas un problème pour moi, mais plus pour Jean. Je me suis vite demandé s’il allait tenir six semaines devant des fonds bleus, avec des balles de tennis. C’était mon inquiétude.
Ensuite, il a fallu se demander comment on allait gérer tous les objets avec lesquels il interagit. Quand on pouvait les fabriquer comme la maison de poupées, on les a faits. Sinon, c’était à lui de les imaginer. Mais on l’a guidé, car on avait des modélisations 3D. Mon travail était de lui montrer, sur le plateau, ce que ça donnerait à l’écran, pour l’aider à jouer.
Jean, pour construire ce personnage, avez‑vous envisagé le film comme un survival à la Seul au monde, ou comme un conte philosophique sur la résilience, comme le disait Jan ?
Jean Dujardin : c’est un peu tout ça. Un conte pour adultes, enfin, un conte pour tous, mais aussi pour adultes. Si on fait référence au film avec Tom Hanks, je crois qu’il l’aurait joué de la même manière, dans la cave. C’est surtout un film sur la solitude, sur l’abandon. On aurait pu en faire une version sociale : un homme seul en cellule, ou seul dans son appartement. Il passerait par le même désarroi, la même souffrance. En fait, je mange ce que je peux, je bois ce que je trouve, j’essaie de dormir, et de me protéger. J’ai des peurs qui m’habitent, j’ai peur… Je ne crois pas qu’il y ait un seul moment dans le film où mon personnage n’ait pas peur. C’est ça qui le fait réagir, qui lui donne du courage. Il faut passer par la peur pour se transcender.
Je pensais à tout ça. Je ne pensais même pas à un film d’aventures. Je me demandais : qu’est‑ce que ça crée, l’abandon ? Même dans nos vies… Quand on voit quelqu’un d’isolé dans la rue, qui traîne seul, abandonné socialement, qui n’existe plus… Qu’est‑ce que ça crée chez lui ? J’ai de la compassion pour ces situations. Ça me touche, ça me fait mal de voir quelqu’un d’isolé. Forcément, je me mets à sa place.
D’ailleurs, ce rôle a quelque chose de très physique. On est presque dans la pantomime, comme dans The Artist ?
Jean Dujardin : je ne fais pas grand‑chose avec mon corps, en fait. Pour The Artist, je devais singer, avancer, faire croire… mais j’avais la musique pour me soutenir. Là, je n’ai pas l’impression de faire énormément de choses, à part subir. Comme je le disais, ce personnage s’est construit dans la peur. On ne réagit pas de la même manière quand on a peur. C’est l’émotion qui a guidé mon corps. Si je n’y croyais pas, je pense que le corps n’aurait pas suivi. Et c’était le travail de Jan de m’aider à y croire. Ce sont des choses qu’on occulte, en fait. Quand on tourne, c’est assez instinctif. Moi, je dois juste donner assez de matière à mon metteur en scène. Je suis comme une banque d’images pour lui. Je veux qu’il ait assez de choix pour son montage.
Pour être totalement transparent, pour moi, L’homme qui rétrécit, c’est un peu un plaisir à retardement, dans le sens où je sais très bien que je ne vais pas avoir une satisfaction immédiate de mon travail sur le plateau. Je savais que ça passerait par des semaines de montage, des mois d’effets spéciaux. Quand j’ai enfin vu le film terminé, là, j’ai eu mon plaisir. Mon plaisir passait par celui de Jan, des autres acteurs, de Mac Guff qui a fait les effets spéciaux… Il passait par toutes ces personnes. C’est tellement d’étapes, ce film.
Je sais ce que j’ai vécu moi, durant le tournage, dans mon coin. Mais je savais aussi que mon plaisir viendrait plus tard. Et ce n’est pas grave. Dans mon travail, je ne cherche pas forcément une émotion immédiate. D’ailleurs, il me reste de ce tournage quelque chose de très intime. Le film que j’ai vécu n’est pas forcément celui que Jan a vécu.
Jan, au final, est‑ce facile, en tant que réalisateur, de rester maître d’un tel projet sans se faire dépasser par son ampleur ?
Jan Kounen : Oui et non. J’ai toujours l’impression que le metteur en scène est un peu un chef d’orchestre. À un moment, il faut faire jouer tout le monde ensemble : Jean, Mac Guff, la déco, les costumes… On est dans la gestion. Moi, je ne suis pas un metteur en scène qui dit : « Le plan est comme ça, et je le veux comme ça ». Je dois répondre à des tas de questions pour construire le plan. Avec l’imaginaire des autres, tous ensemble. Petit à petit, on propose d’autres choses, on fait des choix…
Oui, ce tournage a été compliqué, mais je travaillais avec des gens que je connais depuis longtemps. Donc, j’avais confiance devant et derrière la caméra. À partir de là, on est tous sur le même bateau. La seule difficulté, c’était de s’adapter aux contraintes, pas de faire passer une vision. Car cette vision, c’est un élan qui part vers le comédien, vers les techniciens. Une vision qu’on ajuste, tous ensemble. Le cinéma, c’est un travail collectif. Donc, je n’ai rien à imposer. Je dois juste donner une mélodie qui permet à cette vision de se construire.