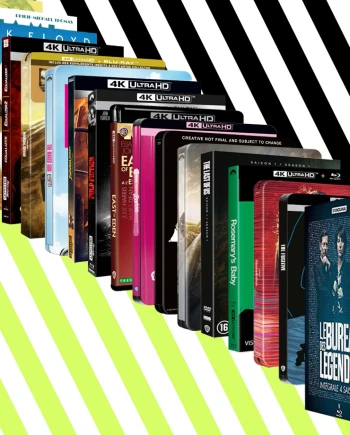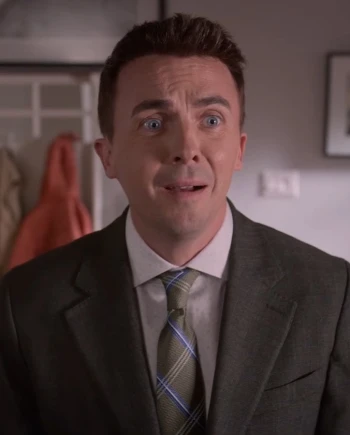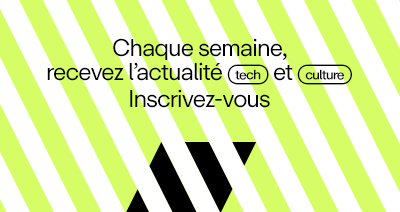Pour la plupart des spectateurs, Ingmar Bergman, le plus célèbre des cinéastes nordiques (il est né en Suède en 1918 dans une petite ville appelée Upsala), évoque une forme d’austérité, de rigueur, d’épure même, tant dans la mise en scène que dans le choix des sujets, rarement gais. Sourires d’une nuit d’été, qui obtint la Palme d’or à Cannes en 1955, et surtout Le septième sceau, œuvre majeure qu’il réalise en 1956, le firent connaître du grand public.
« La vie n’est rien d’autre qu’un voyage cruel et dénué de sens vers la mort », dit l’un des personnages de Prison, un film qu’il réalise en 1948. Tout Bergman est là : l'angoisse existentielle, le doute sur la condition de l’Homme, le questionnement permanent sur la place de l’individu sur Terre, et l'interrogation sur le couple, thème qui occupa une place majeure dans son œuvre.
La mort rôde partout
Le réalisateur de La source creusa en quarante ans de carrière le même sillon : celui du désespoir, chevillé au corps de ses personnages, de la solitude ontologique, et de la mort, peut-être l’héroïne centrale de son œuvre. C’est autour d’un défunt que trois sœurs et une servante se réunissent dans une propriété familiale dans le magnifique Cris et chuchotements (1972), l’un de ses derniers films ; c’est la mort qui guette la mère malade du Silence (l’un de ses films les plus éprouvants) ; c’est la mort qui attend le vieillard des Fraises sauvages, qui en profite pour se souvenir d’une vie remplie d’occasions manquées ; c’est le viol puis la mort qui frappent une jeune fille dans La source (un film dont Wes Craven proposera un remake ultra-violent avec La dernière maison sur la gauche en 1972) ; c’est enfin la mort en personne qui surgit devant le chevalier Antonius Block (Max Von Sydow, l’un des interprètes préférés de Bergman avec Liv Ullmann) dans Le septième sceau.
Les influences
Mais Bergman fut aussi sans doute l’un des cinéastes les plus modernes, qui influença bon nombre de réalisateurs, à commencer par Bille August (son fils spirituel naturel : Les meilleures intentions et Infidèle), et aussi Woody Allen qui, dans ses opus les plus sombres, emprunta les chemins du maître. Ainsi, Une autre femme, Maris et femmes et surtout September, constituent de vibrants hommages au cinéaste suédois.
Les débuts
Issu d’une famille de Luthériens très stricts, Ingmar Bergman se lance dans le théâtre à l’âge de vingt ans et monte de nombreuses pièces avant d’intégrer en 1942 l’équipe de la Svensk Filmindustri comme script doctor. Trois ans plus tard, Bergman fait ses débuts derrière la caméra avec Crise, mais il lui faudra attendre 1952 pour que s’affirme sa maturité avec L’attente des femmes et Monika, l’un des jalons de la modernité cinématographique. Après une dizaine de films, sa carrière internationale débute enfin.
Le tournant
En 1956, il signe son film le plus célèbre : Le septième sceau. Il se déroule au XIVe siècle tandis que la peste décime les populations d’Europe. Un chevalier et son écuyer, de retour au pays après dix années de croisades, sont poursuivis par un être mystérieux, la Mort en personne, qui leur propose de jouer une partie d’échecs. Ils gagnent la partie, mais celle‑ci veut sa revanche et attendra son heure pour battre celui qu’elle est venue chercher afin de l’emmener au royaume des morts. Allégorie puissante sur la condition humaine (vivre, c’est attendre notre heure), conte merveilleux et macabre, Le septième sceau constitue sans doute l’un des chefs‑d’œuvre du cinéma.
Dernier virage
À partir des années 60, les films de Bergman prennent une tournure plus épurée et plus centrée sur les problèmes de couple. Ce seront À travers le miroir, Le silence et surtout les six épisodes de Scènes de la vie conjugale, tournés à l’origine pour la télévision. Au crépuscule de sa vie, Bergman livrera des films élégiaques et touchants, à l’instar de Sonate d’automne, l’histoire d’un concertiste en lutte avec sa propre fille, et le magnifique Fanny et Alexandre.